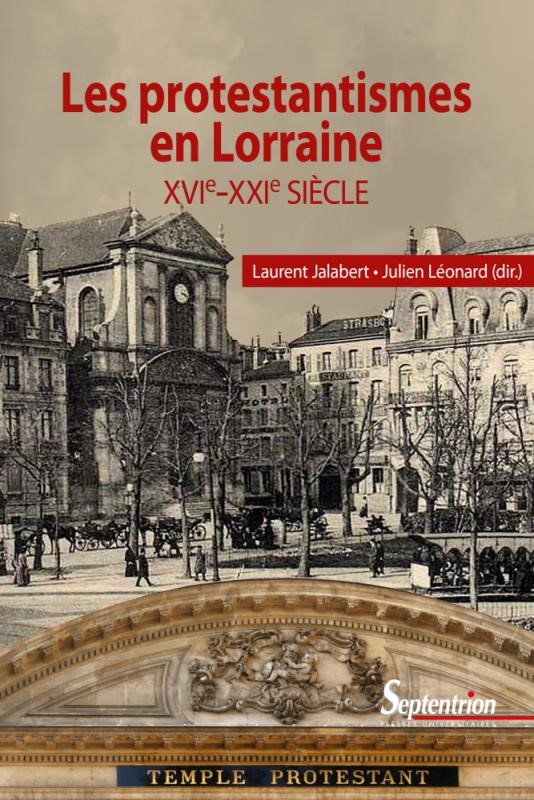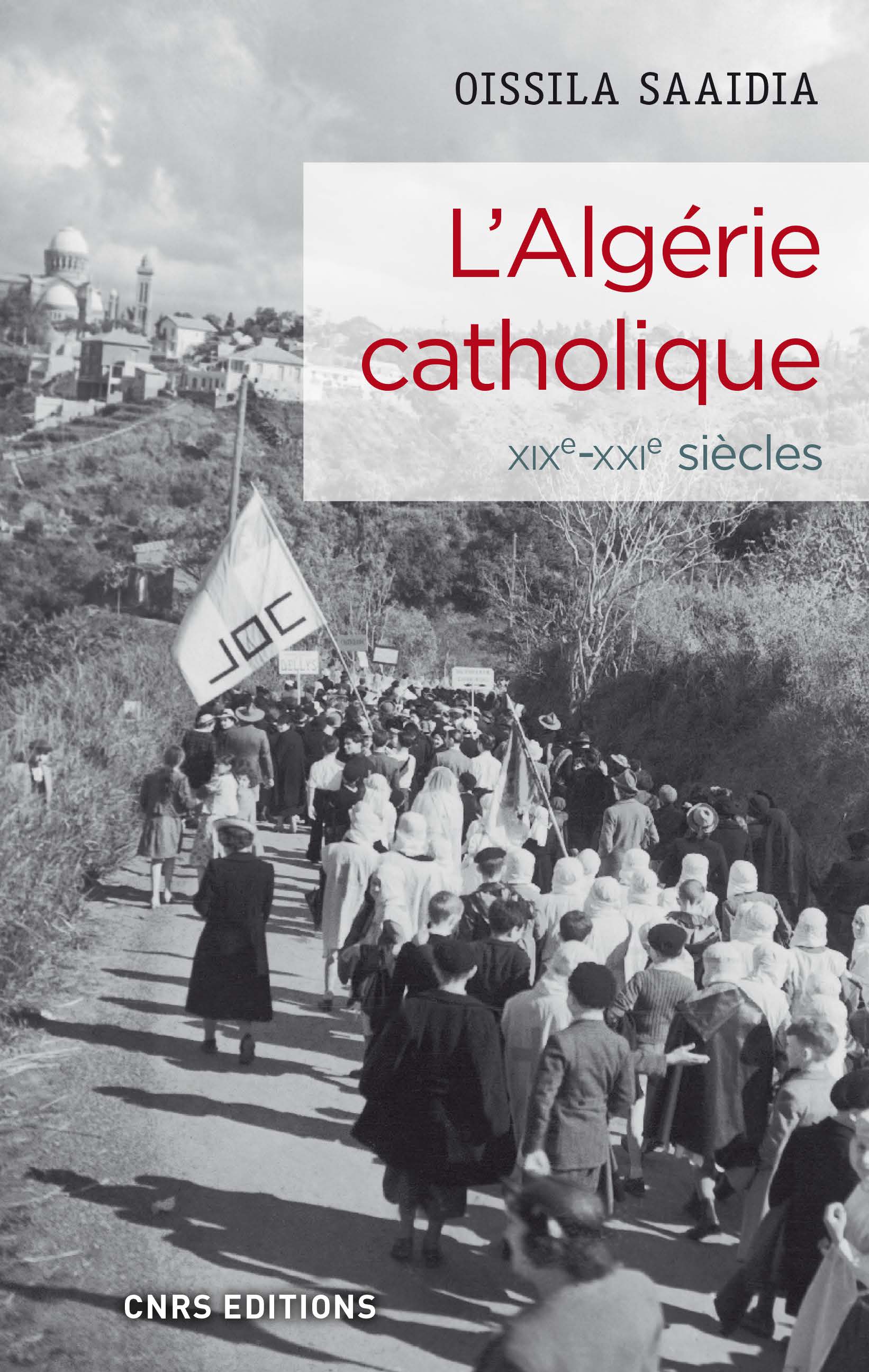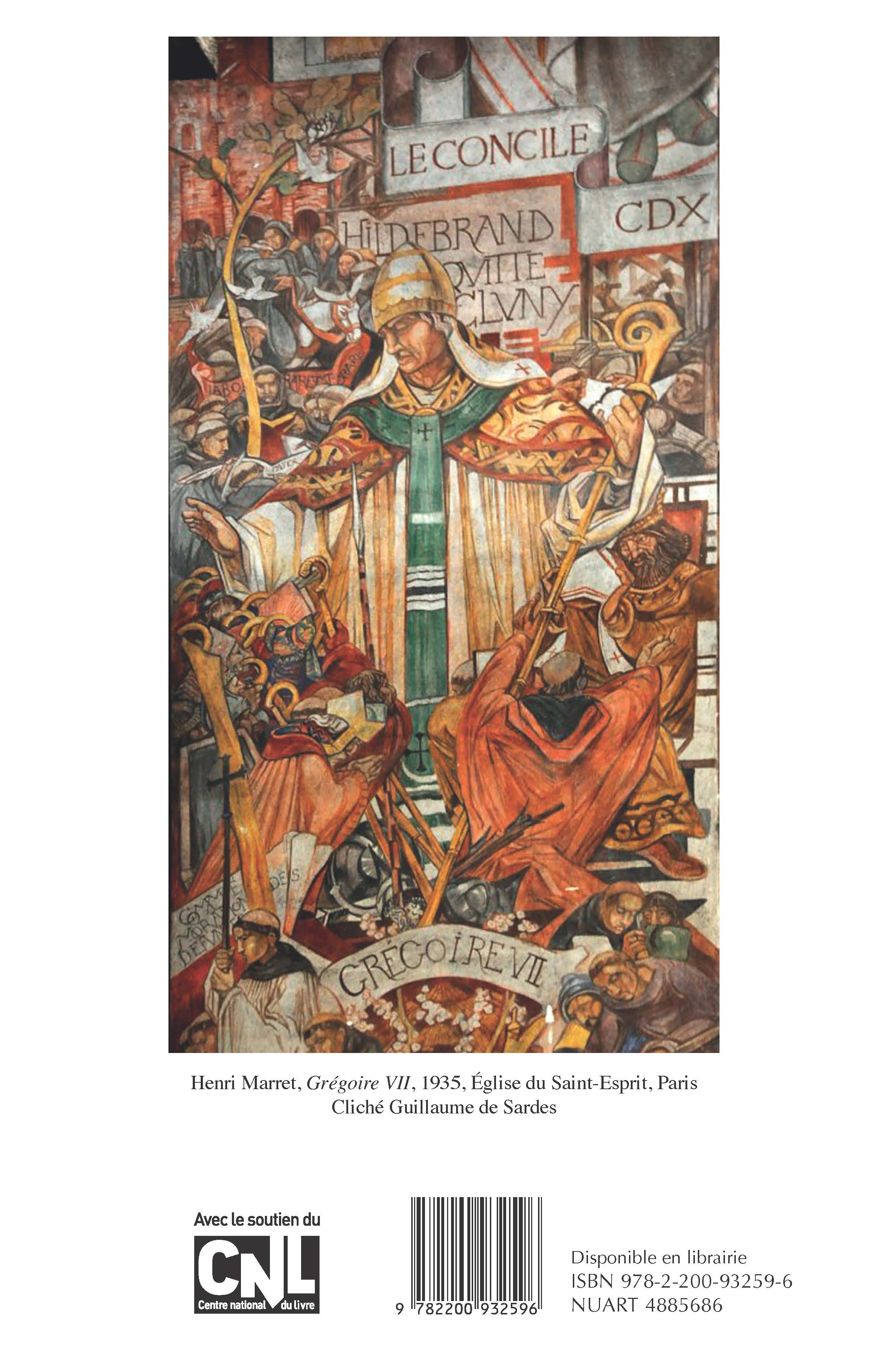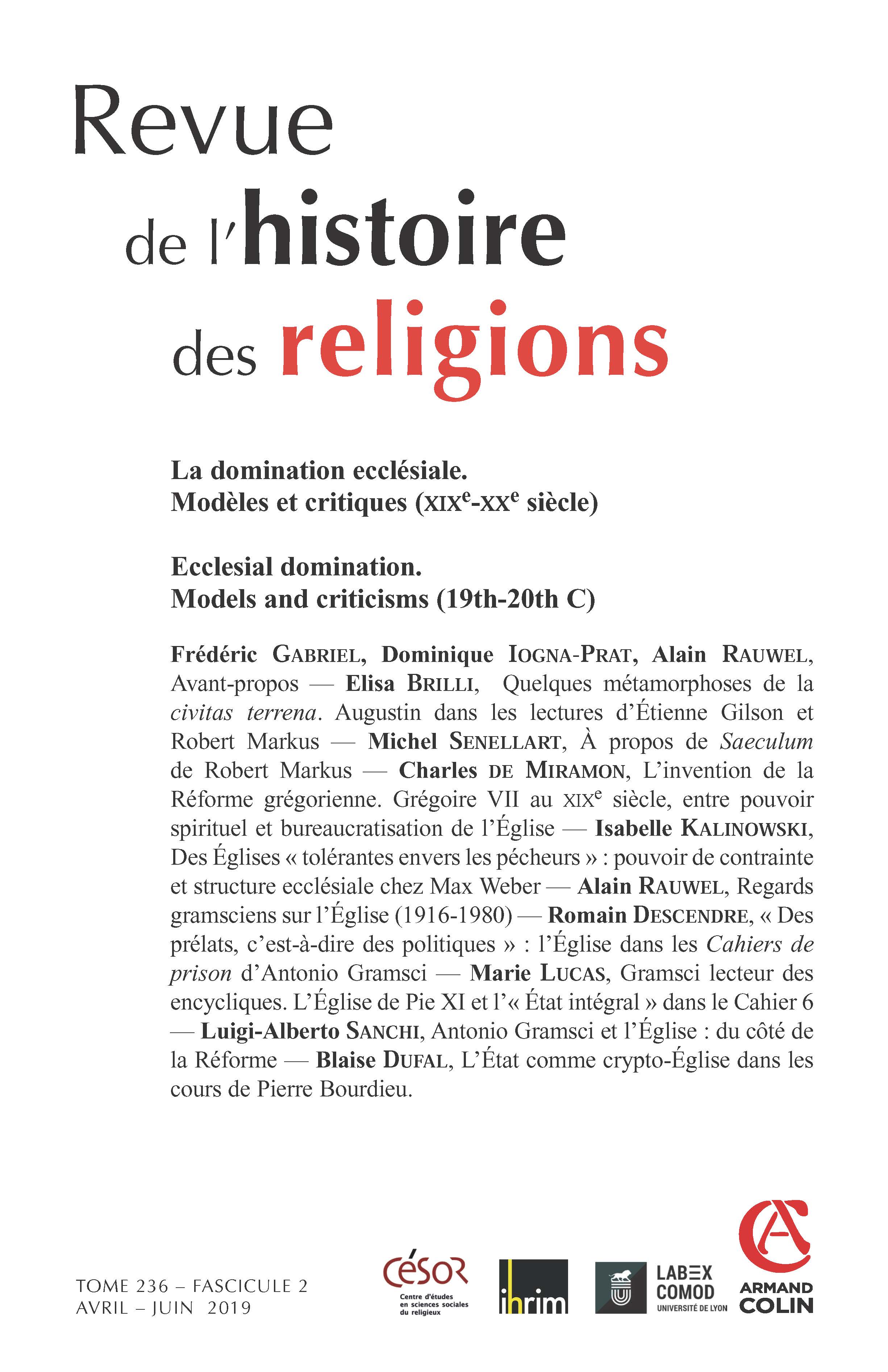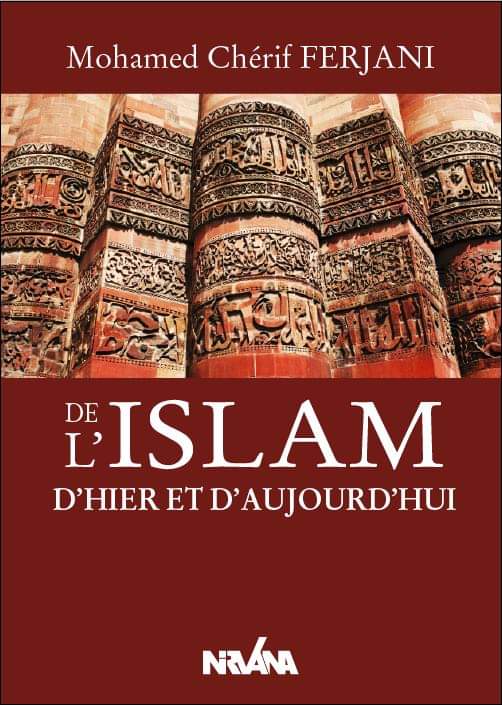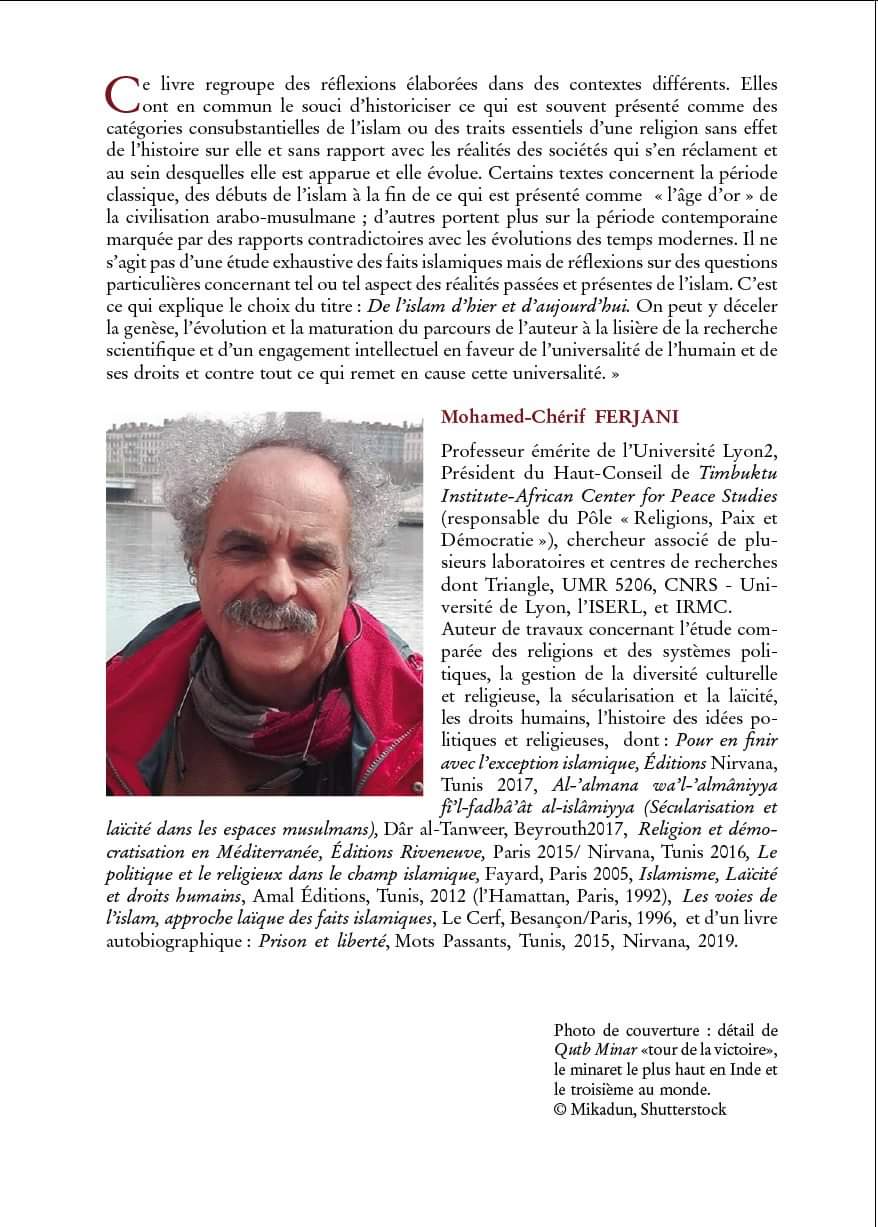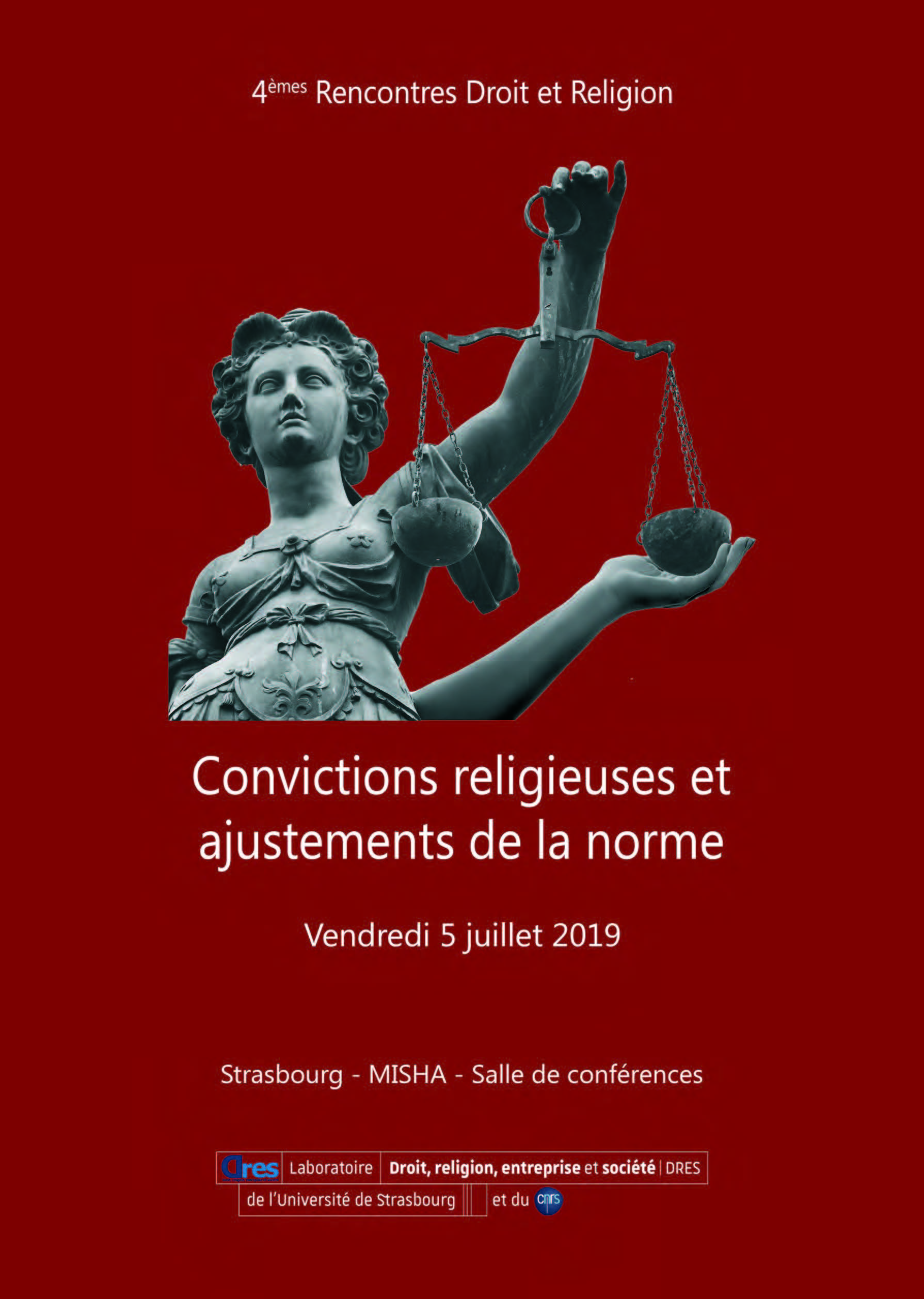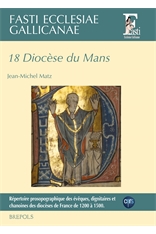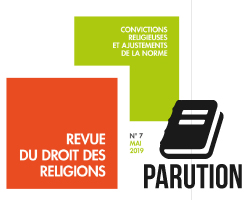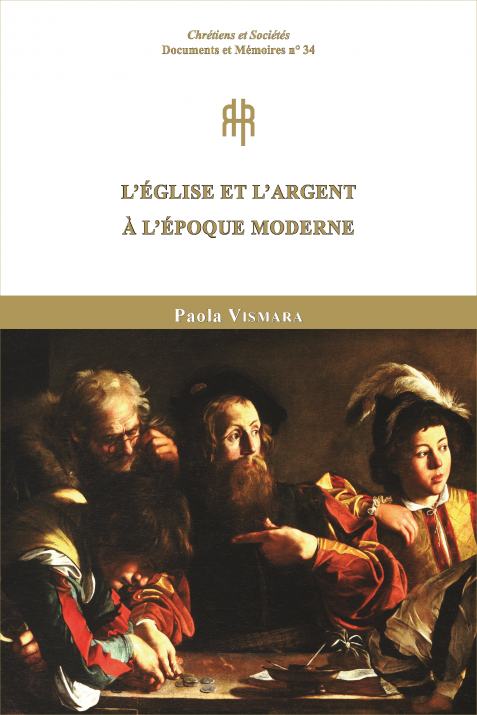
Auteur : Paola VISMARA
Présentation : Frédéric MEYER
Traduction : Stefano SIMIZ
Collection Chrétiens et Sociétés, Documents et Mémoires, 2019.
L’ouvrage se concentre sur la période moderne, qui a hérité du Moyen Âge quelques importantes incitations, provenant en particulier du monde franciscain et, pour certains, déjà du monde monastique. Dans l’Italie de la fin du Moyen Âge naissent les assurances et les banques modernes ; les Flandres et d’autres aires européennes connaissent également un impressionnant développement. Ces nouveautés sont rendues possibles par les grandes mutations du temps, à commencer par la découverte du Nouveau monde et ses incidences sur le plan économique. Il est alors indispensable de repenser, de rénover et de proposer des réflexions inédites, en mesure de répondre à la mutation et aux enjeux en cours. L’objet central du livre est le prêt à intérêt. Ce n’est qu’avec le temps qu’on distingue l’usure du prêt à intérêt légitime et non condamnable. C’est une affaire d’importance. En elle se reflètent les grands confits qui agitent l’intérieur même de l’Église, surtout dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle représente aussi une grille de lecture très intéressante pour mieux comprendre l’évolution générale de l’Église. Cela concerne tous les membres de la société : les riches qui possèdent un capital à investir ; les marchands qui, même riches, ont besoin d’un capital liquide afin de développer leurs affaires. Cela concerne aussi les pauvres qui ont besoin d’argent pour subvenir à leurs premières nécessités ; cela concerne enfin les petites institutions ecclésiastiques et les personnes aux faibles ressources, qui possèdent néanmoins quelques liquidités et doivent vivre sur le profit généré par celles-ci.